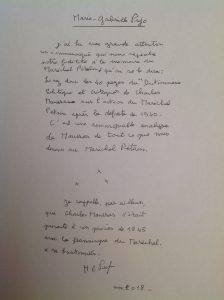Messes pour Louis XVI et hommages en 2021

Ces Messes pour Louis XVI, dites partout en France – et à l’étranger – depuis 1793, ne sont pas de pure commémoration. Elles DOIVENT surtout, pour aujourd’hui, nourrir le processus de dérévolution dont la France a tant besoin pour renouer avec son Histoire, se replacer dans le droit fil de sa trajectoire historique et, s’il se peut, reprendre, un jour, sa marche en avant.
– MERCREDI 20 JANVIER
⚜ AMIENS (80) :18h30,Chapelle Saint-Vincent-de-Paul
– JEUDI 21 JANVIER
⚜ PARIS (75) : 19h Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile
– Église Saint Germain l’Auxerrois, 18h15.
– Rendez-vous Place de la Concorde, 10h.
⚜ VERSAILLES (78) : 19h Chapelle Notre-Dame des Armées
⚜ BREST (29) : 19h, église Saint Michel.
⚜ BAYONNE (64) : 17h, église Saint-Amand.
⚜ TOULOUSE (31) : 18h30, Messe en Mémoire du Roi Louis XVI Place saint-Roch
⚜ BIARRITZ (64) : 18h30, église Saint Martin.
⚜ MONTPELLIER (34) : 18h Messe en Mémoire du Roi Louis XVI Chapelle Royale des Pénitents bleus, rue des Étuves
⚜ LOURDES (65) : Messe privée au couvent.
⚜ FABREGUES (34) : 18h30 Au Prieuré Saint-François-de-Sales
⚜ BEAUJEU (69) : Messe à 18h église Saint-Nicolas.
⚜ FONTAINEBLEAU (77) : 19h église du Carmel,
⚜ VIC-FEZENSAC (32) : 18h, Collégiale St Pierre.
⚜ NICE (06) : 10h église Saint-Jacques-le-Majeur
– Église Saint Germain l’Auxerrois, 18h15.
⚜ SAINT-DENIS (93) : Le Mémorial de France à Saint Denys, fera célébrer par M. l’abbé Thierry Laurent une messe à la mémoire du roi Louis XVI en la basilique Saint-Denys le à 12h00. Métro ligne 13, Arrêt Saint Denys Basilique. Le Mémorial de France à Saint Denys assure ainsi la pérennité de l’ordonnance du roi Louis XVIII, en date de 21 janvier 1815, qui fonda les messes perpétuelles à la mémoire du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.
⚜ MARSEILLE (13) : Église Saint Pie X, 44 rue du Tapis vert (1er arrdt), 12h15.
⚜ BEZIERS (34) : Église Saint-Jacques 16h30.
⚜ GRENOBLES (38) : 16h30 Collégiale Saint-André de Grenoble
⚜ POITIERS (86) : messe à 16h à la Chapelle de Montbernage
⚜ LYON (69) : 18h30 église Saint-Just
– 18h30 église Saint-Georges
⚜ COMPIEGNE : (60) Renseignements compiegne@actionfrancaise.net
⚜ LA ROCHELLE (17) Cathédrale de Saint-Louis Prière de 12h à 14h
⚜ MIREPOIX (09) : 11h à la cathédrale. La messe sera célébrée par le P. David Naït-Saadi, curé de la cathédrale Le prince Jean assistera à la messe à la mémoire de Louis XVI, de la Famille royale et des victimes de la Révolution.
⚜ CARCASSONNE (11) : 11H à la Basilique Saint Nazaire & Saint Celse de la Cité Médiévale de Carcassonne
⚜NANTES (44) : 7h messe chantée, 17h messe basse requiem pour le Roi martyr en l’église Saint Clément
⚜MONTAUBAN (82) : 10h, messe de requiem en l’honneur du roi Louis XVI à l’église saint Jacques, célébrée par le chanoine Mahlberg de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
⚜VALENCE (26) : 16h30, Une Sainte Messe de Requiem à la pieuse mémoire du Roi, sera célébrée à l’église Notre-Dame, rue Marcellin Berthelot
– SAMEDI 23 JANVIER
⚜ AVIGNON (84) : 11 h, messe de Requiem célébrée par l’abbé Vella, assistant général de l’Institut du Bon Pasteur et aumônier de l’Action Française. Chapelle de l’Oratoire, 32 rue Joseph Vernet, un apéritif dinatoire suivra, réservation au 06 46 33 56 95 ou provence@lactionfrancaise.fr
⚜ EPINAL (88) : 11 h, Église Saint Laurent, 3 place du souvenir.
⚜ NIMES (30) 11 h Messe en Mémoire du Roi Louis XVI depuis 1870, cette année à la Chapelle Sainte Eugénie 3 rue sainte Eugénie
⚜ Fontaine-les-Dijon (21) 11h Basilique Saint Bernard
⚜ TOULOUSE (31) Messe de requiem en Mémoire du Roi Louis XVI à la chapelle saint Jean Baptiste 7 rue Antonin Mercié. Métro Capitole ou Esquirol ou Parking Esquirol.
⚜ MOULINS(03) 15h Réservation ici
⚜ STRASBOURG (67) : Messe de Requiem pour Louis XVI, Strasbourg
– DIMANCHE 24 JANVIER
⚜ NANCY (54) : 10h30, Église Marie-Immaculée, 33 avenue du général Leclerc.
⚜ NICE (06) :10h La Chapelle des pénitents rouges, Église Marie-Immaculée