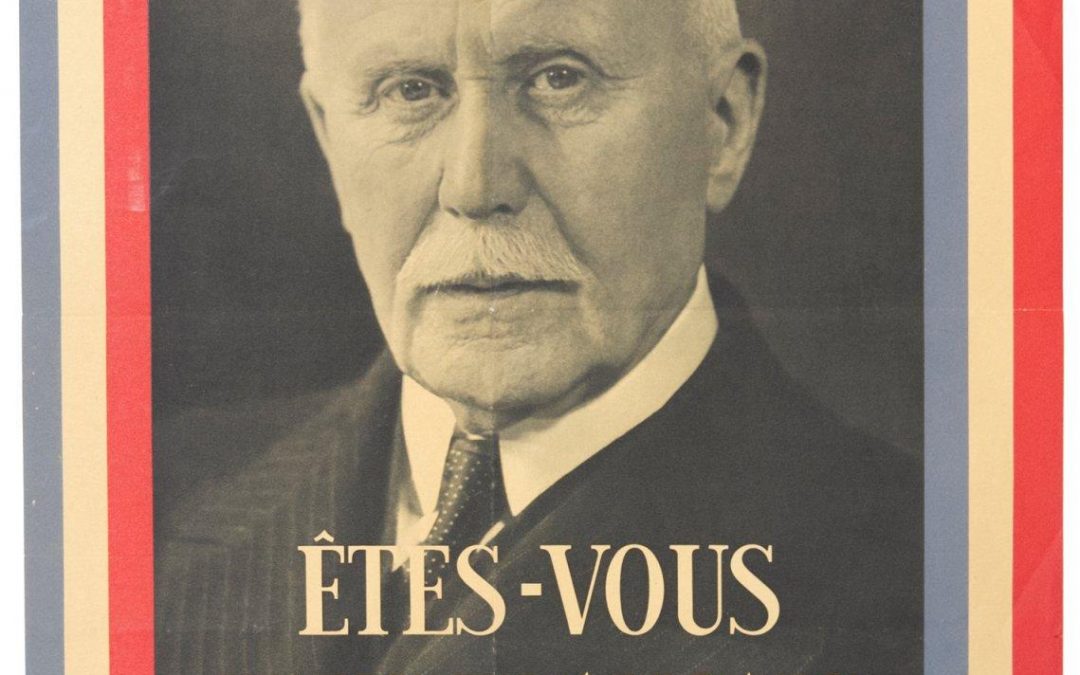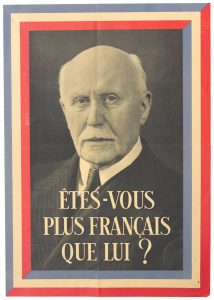Texte paru pour la première fois le 23 septembre 1901 dans la Gazette de France, puis repris en 1937 dans Mes idées politiques et dans les Œuvres capitales.
Amis ou ennemis?
Charles Maurras, 1901
Les philosophes traditionnels refusent constamment de parler des hommes autrement que réunis en société.
Il n’y a pas de solitaire. Un Robinson lui-même était poursuivi et soutenu dans son île par les résultats innombrables du travail immémorial de l’humanité. L’ermite en son désert, le stylite sur sa colonne ont beau s’isoler et se retrancher, ils bénéficient l’un et l’autre des richesses spirituelles accumulées par leurs prédécesseurs ; si réduit que soit leur aliment ou leur vêtement, c’est encore à l’activité des hommes qu’ils le doivent. Absolument seuls, ils mourraient sans laisser de trace. Ainsi l’exige une loi profonde, qui, si elle est encore assez mal connue et formulée, s’impose à notre espèce d’une façon aussi rigoureuse que la chute aux corps pesants quand ils perdent leur point d’appui, ou que l’ébullition à l’eau quand on l’échauffe de cent degrés.
L’homme est un animal politique (c’est-à-dire, dans le mauvais langage moderne, un animal social), observait Aristote au quatrième siècle d’avant notre ère. L’homme est un animal qui forme des sociétés ou, comme il disait, des cités, et les cités qu’il forme sont établies sur l’amitié. Aristote croyait en effet que l’homme, d’une façon générale et quand toutes choses sont égales d’ailleurs, a toujours retiré un plaisir naturel de la vue et du commerce de son semblable. Tous les instincts de sympathie et de fréquentation, le goût du foyer et de la place publique, le langage, les raffinements séculaires de la conversation devaient sembler inexplicables si l’on n’admettait au point de départ l’amitié naturelle de l’homme pour l’homme.
— Voilà, devait se dire ce grand observateur de la nature entière, voilà des hommes qui mangent et qui boivent ensemble. Ils se sont recherchés, invités pour manger et boire, et il est manifeste que le plaisir de la compagnie décuple la joie de chacun. Cet enfant-ci s’amuse, mais il ne joue vraiment que si on lui permet des compagnons de jeux. Il faut une grande passion comme l’avarice ou l’amour pour arracher de l’homme le goût de la société. Encore son visage porte-t-il la trace des privations et des combats qu’il s’est infligés de la sorte. Les routes sont devenues sûres ; cependant les charretiers s’attendent les uns les autres pour cheminer de concert, et ce plaisir de tromper ensemble l’ennui est si vif que l’un en néglige le souci de son attelage, l’autre l’heure de son marché. La dernière activité des vieillards dont l’âge est révolu est d’aller s’asseoir en troupe au soleil pour se redire chaque jour les mêmes paroles oiseuses. Tels sont les hommes dans toutes les conditions. Mais que dire des femmes ? Leur exemple est cependant le plus merveilleux car toutes se détestent et passent leur vie entière à se rechercher. Ainsi le goût de vivre ensemble est chez elles plus fort que cet esprit de rivalité qui naît de l’amour.
Les pessimistes de tous les temps ont souvent contesté à Aristote son principe. Mais tout ce qu’ils ont dit et pensé a été résumé, vingt siècles après Aristote, par l’ami et le maître de Charles II Stuart, l’auteur de Léviathan, le théoricien de la Monarchie absolue, cet illustre Hobbes auquel M. Jules Lemaître aime trop à faire remonter les idées de M. Paul Bourget et les miennes sur le caractère et l’essence de la royauté.
Hobbes a devancé les modernes théoriciens de la concurrence vitale et de la prédominance du plus fort. Il a posé en principe que l’homme naît ennemi de l’homme, et cette inimitié est résumée par lui dans l’inoubliable formule : l’homme est à l’homme comme un loup. L’histoire universelle, l’observation contemporaine fournissent un si grand nombre de vérifications apparentes de ce principe qu’il est presque inutile de les montrer.
Mais, dit quelqu’un, Hobbes est un pessimiste bien modéré ! Il n’a point l’air de se douter qu’il charge d’une calomnie affreuse l’espèce des loups lorsqu’il ose la comparer à l’espèce des hommes. Ignore-t-il donc que les loups, comme dit le proverbe, ne se mangent jamais entre eux ? Et l’homme ne fait que cela.
L’homme mange l’homme sans cesse. Il ne mange que de l’homme. L’anthropophagie apparaît aux esprits superficiels un caractère particulier à quelques peuplades, aussi lointaines que sauvages, et qui décroît de jour en jour. Quel aveuglement ! L’anthropophagie ne décroît ni ne disparaît, mais se transforme.
Nous ne mangeons plus de la chair humaine, nous mangeons du travail humain. À la réserve de l’air que nous respirons, y a-t-il un seul élément que nous empruntions à la nature et qui n’ait été arrosé au préalable de sueur humaine et de pleurs humains ? C’est seulement à la campagne que l’on peut s’approcher d’un ruisseau naturel ou d’une source naturelle et boire l’eau du ciel telle que notre terre l’a distillée dans ses antres et ses rochers. Le plus sobre des citadins, celui qui ne boit que de l’eau, commence à exiger d’une eau particulière, mise en bouteille, cachetée, transportée et ainsi témoignant du même effort humain que le plus précieux élixir. L’eau potable des villes y est d’ailleurs conduite à grands frais de captation et de canalisation. Retournez aux champs, cueillez-y une grappe ou un fruit ; non seulement l’arbre ou la souche a exigé de longues cultures, mais sa tige n’est point à l’état naturel, elle a été greffée, une longue suite de greffages indéfinis ont encore transformé, souvent amélioré, le bourgeon greffeur. La semence elle-même, par les sélections dont elle fut l’objet, porte dans son mystère un capital d’effort humain. En mordant la pulpe du fruit, vous mordez une fois encore au travail de l’homme.
Je n’ai pas à énumérer toutes les races d’animaux qui ont été apprivoisées, domestiquées, humanisées, pour fournir à la nourriture ou au vêtement des humains. Observez cependant que ces ressources qui ne sont pas naturelles doivent recevoir un second genre d’apprêt, un nouveau degré d’humanisation (pardon du barbarisme) pour obtenir l’honneur de nous être ingérées. Il ne suffit pas de tondre la laine des brebis, il faut que cette laine soit tissée de la main diligente de la ménagère ou de la servante. Il ne suffit pas d’abattre la viande, ou de la découper ; c’est une nécessité universelle de la soumettre au feu avant de la dévorer : travail humain, travail humain. On retrouve partout cet intermédiaire entre la nature et nos corps.
Non, les loups ne se mangent pas de cette manière ! Et c’est parce que le loup ne mange pas le travail du loup qu’il est si rarement conduit à faire au loup cette guerre qui est de nécessité chez les hommes. Le loup trouve dans la nature environnante ce que l’homme est forcé de demander à l’homme. La nature est immense, ses ressources sont infinies ; le loup peut l’appeler sa mère et sa bonne nourrice. Mais les produits manufacturés, les produits humanisés, ceux que l’homme appelle ses biens, sont en nombre relativement très petit ; de là, entre hommes, une rivalité, une concurrence fatale. Le festin est étroit ; tout convive nouveau sera regardé de travers, comme il verra d’un mauvais œil les personnes déjà assises.
Mais l’homme qui survient n’apparaît pas à l’homme qui possède déjà comme un simple consommateur dont l’appétit est redoutable ; c’est aussi un être de proie, un conquérant éventuel. Produire, fabriquer soi-même est sans doute un moyen de vivre, mais il est un autre moyen, c’est ravir les produits de la fabrication, soit par ruse, soit par violence. L’homme y a souvent intérêt, en voici un grand témoignage : la plupart de ceux qui ne sont ni voleurs ni brigands passent leur vie à craindre d’être brigandés ou volés. Preuve assurée que leur réflexion personnelle, leur expérience, la tradition et la mémoire héréditaire s’accordent à marquer l’énergie toujours subsistante des instincts de rapine et de fraude. Nous avons le génie de la conquête dans le sang.
L’homme ne peut voir l’homme sans l’imaginer aussitôt comme conquérant ou conquis, comme exploiteur ou exploité, comme victorieux ou vaincu, et, enfin, pour tout dire d’un mot, comme ennemi. Aristote a beau dire que l’homme est social ; il ne serait pas social s’il n’était industrieux, et les fruits de son industrie lui sont si nécessaires ou si beaux qu’il ne peut les montrer sans être maintes fois obligé de courir aux armes. La défense de ces biens ou leur pillerie, c’est toute l’histoire du monde.
Il y a une grande part de vérité dans le discours des pessimistes qui enchérissent de la sorte sur Hobbes et sur les siens. Je voudrais qu’on se résignât à admettre comme certain tout ce qu’ils disent et qu’on ne craignît point d’enseigner qu’en effet l’homme pour l’homme est plus qu’un loup ; mais à la condition de corriger l’aphorisme en y ajoutant cet aphorisme nouveau, et de vérité tout aussi rigoureuse, que pour l’homme, l’homme est un dieu.
Oui, l’industrie explique la concurrence et la rivalité féroces développées entre les hommes. Mais l’industrie explique également leurs concordances et leurs amitiés. Lorsque Robinson découvrit, pour la première fois, la trace d’un pied nu, imprimée sur le sable, il eut un sentiment d’effroi, en se disant selon la manière de Hobbes : « Voilà celui qui mangera tout mon bien, et qui me mangera… » Quand il eut découvert le faible Vendredi, pauvre sauvage inoffensif, il se dit : « Voilà mon collaborateur, mon client et mon protégé. Je n’ai rien à craindre de lui. Il peut tout attendre de moi. Je l’utiliserai… » Et Vendredi devient utile à Robinson, qui le plie aux emplois et aux travaux les plus variés. En peu de temps, le nouvel habitant de l’île rend des services infiniment supérieurs à tous les frais matériels de son entretien. La richesse de l’ancien solitaire se multiplie par la coopération, et lui-même est sauvé des deux suggestions du désert, la frénésie mystique ou l’abrutissement. L’un par l’autre, ils s’élèvent donc et, si l’on peut ainsi dire, se civilisent.
Le cas de Robinson est trop particulier, trop privilégié, pour qu’on en fasse jamais le point de départ d’une théorie de la société. La grande faute des systèmes parus au dix-huitième siècle a été de raisonner sur des cas pareils. Nous savons que, pour nous rendre compte du mécanisme social, il le faut observer dans son élément primitif et qui a toujours été la famille. Mais c’est l’industrie, la nécessité de l’industrie qui a fixé la famille et qui l’a rendue permanente. En recevant les fils et les filles que lui donnait sa femme, l’homme sentait jouer en lui les mêmes instincts observés tout à l’heure dans le cœur de Robinson : « Voilà des collaborateurs, des clients et des protégés. Je n’ai rien à craindre d’eux. Ils peuvent tout attendre de moi. Et le bienfait me fera du bien à moi-même. » Au fur et à mesure que croissait sa famille, le père observait que sa puissance augmentait aussi, et sa force, et tous ses moyens de transformer autour de lui la riche, sauvage et redoutable Nature ou de défendre ses produits contre d’autres hommes.
Observez, je vous prie, que c’est entre des êtres de condition inégale que paraît toujours se constituer la société primitive. Rousseau croyait que cette inégalité résultait des civilisations. C’est tout le contraire ! La société, la civilisation est née de l’inégalité. Aucune civilisation, aucune société ne serait sortie d’êtres égaux entre eux. Des égaux véritables placés dans des conditions égales ou même simplement analogues se seraient presque fatalement entre-tués. Mais qu’un homme donne la vie, ou la sécurité, ou la santé à un autre homme, voilà des relations sociales possibles, le premier utilisant et, pourquoi ne pas dire « exploitant » un capital qu’il a créé, sauvé ou reconstitué, le second entraîné par l’intérêt bien entendu, par l’amour filial, par la reconnaissance à trouver cette exploitation agréable, ou utile, ou tolérable.
L’instinct de protection ou instinct paternel causa d’autres effets. Le chef de famille n’eut pas seulement des enfants engendrés de sa vie. Des fugitifs, des suppliants accoururent à lui, qui, dans un état de faiblesse, de dénuement, et d’impuissance, venaient offrir leurs bras ou même leur personne entière en échange d’une protection sans laquelle ils étaient condamnés à mort. Par des adoptions de ce genre, la famille devait s’accroître. La guerre, qu’il fallut toujours mener à un moment quelconque contre des familles rivales, la guerre apporta un nouvel ordre d’accroissement. Il a toujours été exceptionnel, dans l’histoire du monde, que le groupe victorieux massacrât pour le manger, ou même pour satisfaire sa vengeance, le groupe vaincu. Les femmes de tout âge sont presque toujours réservées, les plus jeunes pour le rôle d’épouses ou de concubines, les plus âgées pour les offices domestiques sur lesquels, de tous temps, on les apprécia. Si le massacre, même celui des guerriers, est chose rare, la réduction à l’esclavage est au contraire un fait si général que Bossuet n’a pu le considérer sans respect. Quand l’on y songe, aucun fait ne peut mieux marquer le prix immense que tout homme attache à la vie et à la fonction d’un autre homme.
— Tu m’étais un loup tout à l’heure, mais aussitôt que j’ai vaincu le loup, je le tue, car il ne peut que me porter de nouveaux préjudices. Or, toi qui es un homme et que j’ai couché et blessé sur le sol, tu m’es comme un dieu maintenant. Que me ferait ta mort ? Ta vie peut au contraire me devenir une nouvelle source de biens. Lève-toi, je te panserai. Guéris-toi, et je t’emploierai.
Moyennant quelques précautions indispensables prises contre ta force et contre les souvenirs de ta liberté, je te traiterai bien pour que tu travailles pour moi. Proche de mon foyer, participant à ma sûreté, à ma nourriture et à toutes mes autres puissances, tu vivras longtemps ; ton travail, entends-tu, ton inestimable travail entre dans ma propriété. Mais je suis bien obligé de te garantir, outre l’existence, la subsistance et tous les genres de bonheur qui seront compatibles avec le mien.
Ainsi le visage de l’esclave était ami au maître. Et, peu à peu, lorsque l’habitude s’en fut mêlée, quand l’oubli eut opéré son œuvre, quand les bons traitements quotidiens eurent fait oublier telle cruauté primitive, le visage du maître devint ami à l’esclave. Il signifia la tutelle et le gouvernement. Après quelques générations, des relations d’un genre nouveau s’établissaient ; en vertu de la réciprocité des services l’esclave se tenait pour un membre secondaire, mais nécessaire de la famille.
Tantôt par le sentiment du péril commun d’où naissaient les pactes de chefs de familles sensiblement égaux entre eux, tantôt par l’abaissement ou la sujétion des familles voisines, la famille primitive s’est étendue jusqu’à former un nouveau groupement civil, un petit état politique ; le mécanisme de sa formation est celui que nous avons déjà vu jouer. L’industrie donne la puissance, détermine la concurrence, fait naître dans le groupe le besoin d’éléments nouveaux ; d’où l’augmentation des familles et leur fédération, d’où encore les portes ouvertes, moyennant certaines conditions d’établissement, aux vagabonds et aux transfuges, et même aux ennemis vaincus. Dans chaque enceinte, le mot d’Aristote se vérifie ; c’est l’amitié qui préside à la fondation de la cité. Mais la formule de Hobbes n’est pas démentie néanmoins ; parce que l’homme est un malfaisant, parce qu’il est un loup à l’homme, l’enceinte se hérisse de murailles, de tours et d’autres ouvrages de fortifications. L’amitié s’établit comme entre les participants d’un foyer, entre les citoyens de la même cité ; aux autres, c’est l’inimitié ou tout au moins la précaution et la méfiance qui se déclarent.
Il ne faut pas entendre par amitié l’amitié pure, ni par inimitié une inimitié absolue. Les étrangers ou, comme on les appelle dans l’antiquité grecque, les barbares, ne sont pas nécessairement des ennemis. Mais d’abord ils sont différents par les mœurs, par la langue, par le costume, par les lois. Et, de plus, leurs déplacements ont presque toujours pour objet un peu de rapine. Néanmoins, il arrive de les recevoir et de les interroger. On répond à leurs questions afin qu’ils répondent à celles qu’on leur pose. La charge de leurs chevaux ou de leurs navires est en outre un grand élément de curiosité, quelquefois de cupidité. Les relations commencent par celles qui sont les plus simples, le commerce par voie d’échange puisqu’il n’existe pas encore de monnaie. Voilà des espèces d’amitiés internationales. Mais elles sont précaires et toutes relatives, en comparaison des causes d’inimitié toujours sur le point d’éclater entre des gens si différents et mus d’intérêts si contraires !
Inversement, à l’intérieur de chaque cité, s’il est bien vrai que l’amitié née de pressants intérêts communs a fait reléguer la vraie guerre hors de l’enceinte et, pour ainsi dire, à la périphérie de ce grand corps, il n’y en a pas moins des vols et des adultères qui se commettent. Les amants rivaux se donnent des coups d’épée et les portefaix concurrents des coups de poing et des coups de couteau. Cependant une paix relative subsiste. L’on se déteste et l’on s’envie, mais pour des sujets de peu d’importance, et sur lesquels la réconciliation demeure facile ou possible.
Du reste, pour répondre au besoin général de paix et d’ordre qui est essentiel à la vie, mais que les progrès de l’industrie rendent impérieux, la cité, la grande communauté civile, déjà naturellement distinguée en familles, en corps de métier, comporte et au besoin suscite la formation de certaines communautés secondaires entre lesquelles les citoyens se distribuent selon leurs affinités et leurs goûts. Ce sont des associations religieuses, des confréries de secours mutuel, des sectes philosophiques et littéraires. Il va sans dire que les membres de chaque corps ne peuvent être en grande sympathie avec les membres du corps voisin ; la sympathie en est resserrée d’autant entre membres de même corps, et c’est un grand bienfait. Deux confréries de pénitents, l’une bleue, l’autre grise, peuvent causer dans une ville, le jour de la fête votive, deux ou trois querelles, et même, une bonne rixe ; l’amitié s’y exerce tout le long de l’année à l’intérieur de chacune pour le plus grand avantage matériel et moral des uns et des autres. Plus la guerre est vive à l’extérieur, plus à l’intérieur la camaraderie se fait étroite et généreuse. L’homme est ainsi fait, et les sociétés qui ont pu traverser les difficultés de l’histoire sont précisément celles qui, connaissant par réflexion ou pressentant d’instinct ces lois de la nature humaine, s’y sont conformées point par point.
Une communauté subsiste tant que parmi ses membres les causes d’amitié, c’est-à-dire d’union, restent supérieures aux causes d’inimitié, c’est-à-dire de division. La police, les tribunaux sont institués pour châtier, réprimer et, s’il le faut, exclure ceux de chaque communauté qui montrent envers leurs confrères ce visage de loup qu’ils devraient réserver à l’ennemi commun. De même des honneurs anthumes ou posthumes ont servi de tout temps à récompenser ceux des membres de la communauté qui se sont montrés les plus « loups » envers l’ennemi ou, s’il est permis d’ainsi dire, les plus « dieux » envers leurs amis et compatriotes. Beaucoup de héros ont été déifiés ainsi, à titre militaire ou à titre civil. Visage de dieu, visage de loup, l’expression alternante du visage de l’homme en présence de l’homme résulte de sa constitution, de sa loi. Naturellement philanthrope, naturellement misanthrope, l’homme a besoin de l’homme, mais il a peur de l’homme. Les circonstances règlent seules le jeu de ces deux sentiments qui se combattent, mais se complètent.
Je ne crois pas qu’ils puissent disparaître jamais. C’est une niaiserie, il me semble, de l’espérer. Les sociétés les plus vastes et qui fondaient les plus étroites « fraternités » furent aussi les plus terribles pour tout ce qui tentait de vivre en dehors d’elles. J’en atteste les souvenirs de l’empire romain qui, en se dilatant par toute la terre habitée, ne pardonnait qu’à ses vaincus et écrasait le reste. La chrétienté si douce, étant donné la rudesse des temps, aux populations abritées dans son vaste sein, s’abandonnait à la violence naturelle de tout instinct quand elle rencontrait des païens ou des Sarrasins. Aujourd’hui, la civilisation anglaise si modérée, si respectueuse, si juridique envers ses citoyens, ne reconnaît ni droit ni force en dehors de sa force ou de son droit. Trait curieux de l’avis de tous ceux qui l’ont vu de près, l’Anglais moderne est personnellement serviable, hospitalier, humain envers l’étranger, quel qu’il soit, qu’il a accueilli près de lui et avec lequel il a conclu l’alliance. Sa volonté formelle a la puissance de créer de ces acceptions de personne. Mais ce sont, comme on dit en droit, des espèces pures, et en dehors desquelles il se croit le devoir de montrer visage de loup à tous les barbares. Son visage de dieu est réservé aux fils de la vieille Angleterre.
On peut railler ce patriotisme, ce nationalisme ingénu. Mais il est conforme à de grandes lois physiques. Il se rattache aux éléments mêmes du genre humain. Pour créer ou pour maintenir un peuple prospère, une civilisation florissante, on n’a pas trouvé mieux, on n’a même pas trouvé autre chose.
Ne dites pas qu’il peut contribuer à la guerre étrangère ; il épargne à coup sûr la guerre civile, qui est la plus atroce de toutes.