
RETOUR SUR LE BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON BONAPARTE

En cette année 2021 a eu lieu la commémoration des deux cents ans de la disparition, en l’île de Sainte-Hélène, de Napoléon Bonaparte, un des personnages les plus prodigieux de l’histoire de France pour le meilleur ou pour le pire. À vrai dire, la commémoration a été troublée par la crise sanitaire du coronavirus, et aussi par les revendications détestables de la « cancel- culture », mode subversive empruntée aux États-Unis qui veut effacer de l’histoire des personnages et des événements qui déplaisent en fonction des prétendues valeurs de notre époque. C’est ainsi que Napoléon Bonaparte, ayant rétabli l’esclavage colonial aux Antilles, a rejoint sur le banc d’infamie d’autres personnages comme Colbert, illustre ministre du Grand Roi, tenu pour responsable de l’édiction du Code noir.
Nous ne nous situons évidemment pas dans cette démarche. L’histoire comporte ses gloires et ses tares, et ce n’est qu’en approfondissant les connaissances, au lieu d’ostraciser et de détruire, que l’on pourra éventuellement prendre parti. Au demeurant, commémorer n’est pas célébrer, ni d’ailleurs dénigrer. Il paraît nécessaire que le pays se penche sur les grandes étapes de son passé afin d’en tirer les leçons : de Bossuet à Maurras, tous les historiens le pensent. Enfin ces indignations rétrospectives est souvent intéressé reposent sur des anachronismes : chaque époque a ses idéaux et ses défauts et juger ce qui s’est passé hier à l’aune d’aujourd’hui expose à ne rien comprendre.
La quantité de domaines dans lesquels a œuvré Napoléon Bonaparte, pour le meilleur et pour le pire, rend sa place dans l’histoire, comme l’on dit, incontournable. Nous ne pourrons en ces quelques lignes nous livrer à un bilan tenté maintes fois, mais qui s’avère difficile. Qu’est-ce qui domine dans la vie et la carrière d’un tel homme ? Le positif, par exemple le retour à la paix religieuse due au concordat, le rétablissement de l’ordre et de l’administration, voire un Code civil bien rédigé, mais non exempt de critiques, ou le négatif : les guerres, la conscription, le despotisme, la mort injuste du duc d’Enghien, sacrifié à une obscure vendetta ?… Et de quel côté mettre les victoires : Austerlitz modèle des batailles ? Iéna ou l’école militaire ? Ou bien Waterloo morne plaine ? Et la gloire ? Et les morts ? Et le sang ? En face de quantité d’initiatives administratives de cet homme épris d’ordre et de travail qui se sont avérées utiles, comme le cadastre, il y a eu des ravages considérables dans toute l’Europe, et un recul conséquent de l’image de la France… Faire la balance de tout cela est très difficile. Et l’homme lui-même échappe aux classifications : est-ce Robespierre à cheval ? Un despote éclairé ? Le continuateur des rois ? Le fondateur d’une nouvelle dynastie? Ou un Washington français ? Depuis deux siècles une quantité écrasante d’études, d’ouvrages et d’articles en discute sans pouvoir arriver à conclure tout à fait…
La place de ce personnage dans l’histoire restera de toute manière éminente: (« Encore une fois, je le trouve grand » a écrit Maurras). En ce qui concerne la compréhension de son action, il nous semble que l’école d’Action Française a apporté une contribution essentielle, en particulier à travers les travaux et les appréciations du trio Maurras, Bainville, Daudet.
 Jacques Bainville a écrit un Napoléon, paru en 1931 et maintes fois réédité, qui est devenu un classique. Notre maître Jean Tulard, lui-même spécialiste éminent de l’époque napoléonienne, le recommandait toujours dans la bibliographie qu’il remettait à ses étudiants, preuve du caractère fondamental et pérenne du fond de l’ouvrage, par ailleurs incomparable par sa clarté et l’aisance de son style. Bainville montre que Napoléon Bonaparte, malgré sa remarquable intelligence et son énergie, a été prisonnier des circonstances qui l’avaient amené au pouvoir : il a été mis en place par des révolutionnaires pour permettre leur maintien (le 18 brumaire, même s’il s’avérera par la suite être un coup d’État de l’ordre, est initialement une tentative de stabilisation du pouvoir républicain afin d’éviter un retour à la royauté). Napoléon Bonaparte, Premier consul puis Empereur, comme Sisyphe poussant vainement son rocher, va être lié inexorablement aux conquêtes de la Révolution, et parmi celles-ci à la possession de la Belgique. Or Anvers est « un pistolet braqué sur le cœur de l’Angleterre », et la Grande-Bretagne restera en guerre tant que la France ne lâchera pas cette conquête. Bainville a bien montré, au milieu des fastes et des déboires de la période, cet héritage révolutionnaire qui sera fatal à Napoléon.
Jacques Bainville a écrit un Napoléon, paru en 1931 et maintes fois réédité, qui est devenu un classique. Notre maître Jean Tulard, lui-même spécialiste éminent de l’époque napoléonienne, le recommandait toujours dans la bibliographie qu’il remettait à ses étudiants, preuve du caractère fondamental et pérenne du fond de l’ouvrage, par ailleurs incomparable par sa clarté et l’aisance de son style. Bainville montre que Napoléon Bonaparte, malgré sa remarquable intelligence et son énergie, a été prisonnier des circonstances qui l’avaient amené au pouvoir : il a été mis en place par des révolutionnaires pour permettre leur maintien (le 18 brumaire, même s’il s’avérera par la suite être un coup d’État de l’ordre, est initialement une tentative de stabilisation du pouvoir républicain afin d’éviter un retour à la royauté). Napoléon Bonaparte, Premier consul puis Empereur, comme Sisyphe poussant vainement son rocher, va être lié inexorablement aux conquêtes de la Révolution, et parmi celles-ci à la possession de la Belgique. Or Anvers est « un pistolet braqué sur le cœur de l’Angleterre », et la Grande-Bretagne restera en guerre tant que la France ne lâchera pas cette conquête. Bainville a bien montré, au milieu des fastes et des déboires de la période, cet héritage révolutionnaire qui sera fatal à Napoléon.
De son côté, Maurras, dans la 3e partie de son étude, Jeanne d’Arc, Louis XIV, Napoléon (1937) – et aussi dans L’Ordre et le Désordre(1948) – s’est livré à une évaluation du personnage. Alors qu’il célèbre les résultats de la dynastie capétienne, plus efficace par son institution, qui a abouti à faire la France, que par les talents fort inégaux de ses représentants, il constate que l’Empire de Napoléon, et aussi celui de son neveu Napoléon III, quelles que soient les qualités personnelles des individus, a mené à des défaites totales et au rassemblement de puissances rivales, l’Allemagne et l’Italie, dont la monarchie avait réussi en son temps à conjurer l’unification. Maurras souligne donc que la nouvelle dynastie impériale, se situant dans le droit fil de la Révolution, a suivi une politique extérieure nuisible pour l’intérêt français. Le Maître de Martigues est également sévère au plan intérieur car, attaché à la décentralisation, il critique le despotisme et l’absence de renaissance des franchises locales. Obligé d’admettre que la monarchie avait elle-même centralisé aux XVII et XVIIIe siècles, Maurras note cependant que la royauté a la possibilité de décentraliser, ce qu’un pouvoir issu de l’élection ne peut pas faire et que Napoléon s’est bien gardé de faire. À la différence du pouvoir démocratique ou impérial, qui veut tout régir, Maurras souhaite une royauté forte dans ses fonctions régaliennes, mais aussi un pays largement auto administré dans le cadre des professions et des provinces. On ajoutera que Maurras, quoique ennemi du parlementarisme, n’avait pas non plus de tendresse pour les tendances plébiscitaires des Bonaparte : il exprime son refus du césarisme dans les deux volumes de De Démos à César, parus en 1930.
Ajoutons enfin la contribution de Léon Daudet, dans un livre sans concession–l’on a parfois parlé d’un « règlement de comptes » – mais qui a le mérite de souligner des points importants : Deux idoles sanguinaires : la Révolution et son fils Bonaparte, paru en 1939. Déjà par son titre, l’ouvrage souligne la filiation et les affinités entre les deux périodes. Daudet consacre à Napoléon les trois derniers chapitres de son livre : « jeunesse et formation d’une idole », « l’assassinat du duc d’Enghien et « une caricature de la monarchie. » Portant la lumière–et le fer- sur quelques épisodes, et en s’aidant dans sa démonstration de nombreuses citations, l’auteur dresse un portrait à charge, non sans intérêt (particulièrement à propos du duc d’Enghien), mais que la sérénité de Bainville permet cependant de nuancer. On observe que, comme Bainville, Léon Daudet insiste sur le caractère infranchissable de l’obstacle anglais. Peut-être convient-il de remettre cette question au centre de l’évaluation de l’aventure napoléonienne : quelle que soit la valeur de l’édifice, il reposait sur un fondement fragilisé.
L’apport des penseurs et des historiens d’Action Française permet d’arriver à une vision équilibrée d’un personnage fascinant et d’une épopée grandiose qui ont abouti à d’immenses déconvenues, que ce soit au plan de la défaite extérieure ou de l’abaissement des libertés. La sagesse de Bainville, la distance critique de Maurras et la verve polémique de Léon Daudet éclairent la compréhension du phénomène napoléonien, qui s’inscrit dans la continuité de la Révolution (laquelle a été remarquablement étudiée par Pierre Gaxotte, autre historien de la même école). Il serait souhaitable qu’une étude historiographique vienne mettre en évidence, d’une manière systématique, la valeur et la portée explicative de cette approche.
François Marceron







 Bien sûr, rien n’est parfait ici-bas. Dès 1054, l’Église d’Europe orientale, préférant ses disputes byzantines à la rigueur latine, se sépara de Rome, au risque de se mettre au service des puissances étatiques. En Occident même, dès le XIVe siècle, le nominalisme de Guillaume d’Occam renvoyait l’homme aux lumières de sa conscience individuelle. Puis des théologiens sorbonnards, laïcistes avant la lettre, voulurent tenter de séparer les fins spirituelles des hommes, des fins temporelles des États, tandis que d’autres soutenaient la primauté des conciles sur la papauté. Climat d’impatience face aux cadres traditionnels, donc profitable – déjà ! – aux hommes d’affaires qui se mirent à rêver d’une Europe réorganisée selon des visées marchandes. En envahissant la France, en lui arrachant même sa dynastie par l’odieux traité de Troyes (1 420), donc en mettant hors-jeu le royaume capétien, l’Angleterre servit fort bien les intérêts des marchands anglo-saxons, mais aussi allemands et bourguignons, qui pourraient ainsi se livrer aux démons de la démesure. La crise était aussi dans l’Église où la hiérarchie se compromettait bien souvent avec ceux qui fabriquaient l’opinion dans un sens hostile à la catholicité romaine. Et pendant ce temps, à l’est, l’islam progressait…
Bien sûr, rien n’est parfait ici-bas. Dès 1054, l’Église d’Europe orientale, préférant ses disputes byzantines à la rigueur latine, se sépara de Rome, au risque de se mettre au service des puissances étatiques. En Occident même, dès le XIVe siècle, le nominalisme de Guillaume d’Occam renvoyait l’homme aux lumières de sa conscience individuelle. Puis des théologiens sorbonnards, laïcistes avant la lettre, voulurent tenter de séparer les fins spirituelles des hommes, des fins temporelles des États, tandis que d’autres soutenaient la primauté des conciles sur la papauté. Climat d’impatience face aux cadres traditionnels, donc profitable – déjà ! – aux hommes d’affaires qui se mirent à rêver d’une Europe réorganisée selon des visées marchandes. En envahissant la France, en lui arrachant même sa dynastie par l’odieux traité de Troyes (1 420), donc en mettant hors-jeu le royaume capétien, l’Angleterre servit fort bien les intérêts des marchands anglo-saxons, mais aussi allemands et bourguignons, qui pourraient ainsi se livrer aux démons de la démesure. La crise était aussi dans l’Église où la hiérarchie se compromettait bien souvent avec ceux qui fabriquaient l’opinion dans un sens hostile à la catholicité romaine. Et pendant ce temps, à l’est, l’islam progressait… Hélas, au XVIe siècle, survint Luther et, avec lui, selon l’expression d’Auguste Comte, « l’insurrection de l’individu contre l’espèce ». Dès lors plus de référence supérieure reconnue par tous ; la conscience pouvait tout réinterpréter ; l’Europe chrétienne était touchée au plus profond de son âme. Ce ne fut pas un progrès. Les nations durent renforcer leurs frontières autant que leur administration intérieure. Pour ne pas laisser le champ libre aux égoïsmes particuliers ou collectifs, elles durent partout fédérer les forces vives et devenir ainsi les éléments irremplaçables d’équilibre, de mesure et d’ordre. L’unité, devenue difficile sur le plan spirituel, devait subsister sur le plan temporel par les nations, lesquelles, d’ailleurs, réalisant la paix intérieure dans une communauté de destin, pouvaient dès lors amplement contribuer au retour de l’unité spirituelle.
Hélas, au XVIe siècle, survint Luther et, avec lui, selon l’expression d’Auguste Comte, « l’insurrection de l’individu contre l’espèce ». Dès lors plus de référence supérieure reconnue par tous ; la conscience pouvait tout réinterpréter ; l’Europe chrétienne était touchée au plus profond de son âme. Ce ne fut pas un progrès. Les nations durent renforcer leurs frontières autant que leur administration intérieure. Pour ne pas laisser le champ libre aux égoïsmes particuliers ou collectifs, elles durent partout fédérer les forces vives et devenir ainsi les éléments irremplaçables d’équilibre, de mesure et d’ordre. L’unité, devenue difficile sur le plan spirituel, devait subsister sur le plan temporel par les nations, lesquelles, d’ailleurs, réalisant la paix intérieure dans une communauté de destin, pouvaient dès lors amplement contribuer au retour de l’unité spirituelle. Le coup fatal fut porté par la Révolution de 1789. Le mot nation lui-même fut dénaturé. Il ne s’agit plus, selon l’idéologie libertaire, de communauté scellée par l’Histoire, mais d’une association nouvelle à laquelle on appartient par un acte de simple volonté individuelle. Dès lors, l’État, création de la volonté générale souveraine, ne put que s’ériger en absolu, confinant la foi dans le for intérieur de chacun et détruisant les florissantes libertés séculaires des métiers et des provinces, afin que chacun pût « librement » faire coïncider sa volonté avec la mythique « volonté générale ». L’on vit aussi apparaître la guerre révolutionnaire, qui n’avait plus grand chose de commun avec les querelles traditionnelles des rois pour agrandir leurs domaines : les masses s’y trouvèrent engagées, au nom d’une idéologie à imposer au reste du monde et qui engendrait la haine obligatoire de l’étranger, considéré comme l’obstacle à la réalisation du Progrès… Ainsi la Révolution, se réclamant de la « nation », mit-elle pour vingt ans, l’Europe à feu et à sang. Plus grave encore : l’idéologie volontariste exportée, suscita partout des « nationalismes » d’un nouveau genre, qu’il serait plus juste d’appeler nationalitarismes puisque nés dans le mépris de l’Histoire, fondés uniquement sur la volonté des individus, sur l’idée des Droits de l’Homme déifiés, sur l’idée de contrat passé entre gens « libres et égaux » voulant vivre ensemble et se suffire à eux-mêmes. Ces « nations » créées artificiellement, disloquant de vastes ensembles aux bienfaits séculaires (pensons à l’empire austro-hongrois), devinrent autant de foyers d’instabilité dans le monde ; les guerres de 1914-18 et 1939-45 en sortirent.
Le coup fatal fut porté par la Révolution de 1789. Le mot nation lui-même fut dénaturé. Il ne s’agit plus, selon l’idéologie libertaire, de communauté scellée par l’Histoire, mais d’une association nouvelle à laquelle on appartient par un acte de simple volonté individuelle. Dès lors, l’État, création de la volonté générale souveraine, ne put que s’ériger en absolu, confinant la foi dans le for intérieur de chacun et détruisant les florissantes libertés séculaires des métiers et des provinces, afin que chacun pût « librement » faire coïncider sa volonté avec la mythique « volonté générale ». L’on vit aussi apparaître la guerre révolutionnaire, qui n’avait plus grand chose de commun avec les querelles traditionnelles des rois pour agrandir leurs domaines : les masses s’y trouvèrent engagées, au nom d’une idéologie à imposer au reste du monde et qui engendrait la haine obligatoire de l’étranger, considéré comme l’obstacle à la réalisation du Progrès… Ainsi la Révolution, se réclamant de la « nation », mit-elle pour vingt ans, l’Europe à feu et à sang. Plus grave encore : l’idéologie volontariste exportée, suscita partout des « nationalismes » d’un nouveau genre, qu’il serait plus juste d’appeler nationalitarismes puisque nés dans le mépris de l’Histoire, fondés uniquement sur la volonté des individus, sur l’idée des Droits de l’Homme déifiés, sur l’idée de contrat passé entre gens « libres et égaux » voulant vivre ensemble et se suffire à eux-mêmes. Ces « nations » créées artificiellement, disloquant de vastes ensembles aux bienfaits séculaires (pensons à l’empire austro-hongrois), devinrent autant de foyers d’instabilité dans le monde ; les guerres de 1914-18 et 1939-45 en sortirent.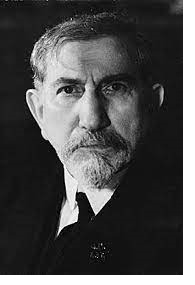 Donc le nationalisme ne remplace pas le patriotisme, il le renforce même en le réenracinant dans le terroir familier des provinces à faire revivre, mais il le dépasse. Par exemple, lorsque sainte Jeanne d’Arc boutait les Anglais hors de France, elle agissait par patriotisme ; mais sa mission était bien plus élevée : elle consistait à rendre au pays les moyens de renouer avec le meilleur de ses traditions. Là est le nationalisme.
Donc le nationalisme ne remplace pas le patriotisme, il le renforce même en le réenracinant dans le terroir familier des provinces à faire revivre, mais il le dépasse. Par exemple, lorsque sainte Jeanne d’Arc boutait les Anglais hors de France, elle agissait par patriotisme ; mais sa mission était bien plus élevée : elle consistait à rendre au pays les moyens de renouer avec le meilleur de ses traditions. Là est le nationalisme.

 C’est à l’âge de 68 ans que le penseur savoyard de la Contre-révolution a fini ses jours ; il venait de recevoir le grade de Président de la Chancellerie du Piémont et de ministre d’État du Royaume de Sardaigne, ainsi qu’un siège titulaire à l’Académie de Turin.
C’est à l’âge de 68 ans que le penseur savoyard de la Contre-révolution a fini ses jours ; il venait de recevoir le grade de Président de la Chancellerie du Piémont et de ministre d’État du Royaume de Sardaigne, ainsi qu’un siège titulaire à l’Académie de Turin. Déjà, un de ses disciples, l’espagnol Donoso Cortès, déplorait que Dieu ait abandonné les hommes. Cette attitude se résume dans cet aphorisme, presque toujours mal compris : « La Contre-révolution n’est pas la révolution en sens contraire, mais le contraire de la révolution. » En fait, dans cette maxime, Maistre prophétise ce qui s’est effectivement produit en 1814 . Sauf qu’après la première Restauration, il y a les Cent-jours, qui brisent l’élan de la reconstruction de la société et de l’Etat. L’apocatastase n’a été qu’une illusion. Le Savoyard n’a pas vécu assez longtemps pour accommoder à cette réalité. Il n’a connu ni le triomphe du consalvisme, ni le changement de branche dynastique dans le Royaume de Sardaigne. Il est mort trop tôt.
Déjà, un de ses disciples, l’espagnol Donoso Cortès, déplorait que Dieu ait abandonné les hommes. Cette attitude se résume dans cet aphorisme, presque toujours mal compris : « La Contre-révolution n’est pas la révolution en sens contraire, mais le contraire de la révolution. » En fait, dans cette maxime, Maistre prophétise ce qui s’est effectivement produit en 1814 . Sauf qu’après la première Restauration, il y a les Cent-jours, qui brisent l’élan de la reconstruction de la société et de l’Etat. L’apocatastase n’a été qu’une illusion. Le Savoyard n’a pas vécu assez longtemps pour accommoder à cette réalité. Il n’a connu ni le triomphe du consalvisme, ni le changement de branche dynastique dans le Royaume de Sardaigne. Il est mort trop tôt.

